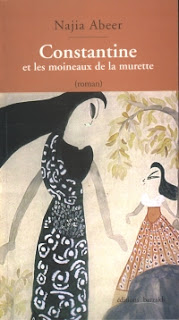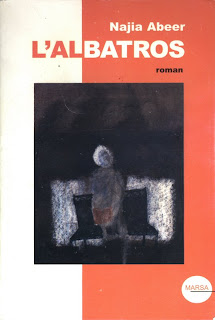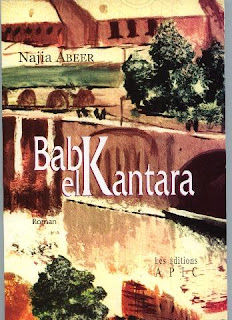J'ai mis du temps, avant de publier ce message. Non pas parce que je ne savais pas où était ma conviction, mais parce que les dés sont pipés et que le terrain est miné. Sur des sujets comme celui-là, on ne peut plus, aujourd'hui se contenter de son intime conviction; il faut se garder des interprétations, des procès d'intention, des faux-semblants, des prétextes, des lobbies, de l'air du temps, bref pour une grande part de la désormais sacro-sainte communication !
C'est aussi pourquoi, je commencerai par des préalables, afin d'espérer être compris. Je le constate, il est bien fini le temps où la sincérité du propos suffisait. Il y a quelques années, je n'hésitais pas, sur un tel sujet, à livrer un avis tranché. Aujourd'hui, ça n'est plus possible et je le regrette.
Je prends tout de même la précaution de dire avec force combien je suis étranger aux propos intellectualistes, somme toute faciles et surtout soucieux de donner une certaine image de celui qui les exprime, lorsque ça n'est pas pour brouiller les pistes. Pour autant, je ne conteste pas, loin de là, aux intellectuels le droit, voire le devoir, d'alerter l'opinion.
Il m'apparaît comme très important de distinguer la réaction d'un occidentaml de celle d'un ressortissant arabe. Lorsque l'on vit le conflit, quelle que soit la façon dont on se place, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions de réflexion que lorsqu'on y est extérieur. Ma qualité d'"Algérien-Français" me permet de le dire et c'est comme cela que je réagis moi-même, au premier abord. Combien les débats de salon sont relativisés par une telle remarque !
Je dois également à l'honnêteté d'exprimer ma très grande gêne par rapport à la position exprimée par les pays arabes, en général. Sentiment de malaise parce que le boycott prôné est en totale contradiction avec la façon dont ils règlent leurs problèmes intérieurs, notamment au niveau des libertés, et de la faiblesse de leur soutient à la Palestine.
Enfin, puisque ce sujet est très sensible, au regard du contexte historique et international et de l'exploitation qui en est faite, j'affirme que je ne mélange pas peuple israélien que je respecte et pouvoir israélien et je me garde bien de faire l'amalgame avec le sionisme ou le problème juif qui sont d'autres domaines de débat. De la même façon, je ne confonds pas islam et islamisme, peuple des pays arabes et gouvernement.
J'ai beaucoup lu sur le fait de savoir s'il fallait ou non boycotter le salon du livre de Paris. Plus pour mieux y réfléchir et ne pas risquer de me fourvoyer que pour déterminer ma conviction sur le sujet qui est que OUI le boycott organisé et accompagné par des actions fortes, concertées est la plus honnête des positions, si l'on veut bien considérer la question uniquement sous l'angle de la conviction profonde, indépendamment du reste, de tout ce qui touche aux calculs et aux apparences. En d'autres temps cette démarche de conviction m'aurait été plus spontanée et non susceptible d'aménagements, comme c'est la cas aujourd'hui puisqu'il me faut bien admettre que pour être efficace, il faut désormais prendre en compte les approches communicantes, les méthodes modernes qui régissent le débat public qui est souvent loin de l'échange d'idées et au plus près des intérêts étroits des individus, des groupes ou des institutions.
La polémique qui a accompagné la tenue de ce salon est là pour soutenir ce que je viens d'exposer. C'est pourquoi, je pense que, malheureusement, le boycott ne pouvait pas être une réponse capable d'éclairer les choses et que la manipulation politique, politicienne, l'étroitesse des motifs ne pouvaient que conduire à le vider de son véritable sens et de son authentique pouvoir : influer sur l'opinion internationale, interpeller les peuples pour que cesse enfin le martyre du peuple palestinien.
Dans ces conditions, il fallait organiser la riposte à ce qui m'apparaît comme une provocation, au vu du contexte israélo-palestinien. Cette nécessité s'imposait aux états arabes comme aux intellectuels de ces pays, à commencer par les écrivains, afin de délivrer un message clair et de faire de cet évènement une tribune pour la cause la plus noble qui soit : la PAIX et l'affirmation que le peuple palestinien a le droit d'avoir un pays qui se développe dans le respect de ses voisins et dans l'affirmation de son identité. Quant à nos intellectuels, il aurait été bienvenu que leur position soit concertée et sans rapport avec les intérêts personnels de tel ou tel !
Force est de constater que malheureusement cette démarche n'a pas prévalu. Le résultat sera donc que le débat a été dévié et que la cause du peuple palestinien comme celle de la paix n'aura pas avancé.
Nous avons donc assisté à l'exposé d'arguments qui n'avaient pour but que de légitimer des choses peu avouables. Fallait-il inaugurer ce salon avec le chef de l'État israélien ? Non, au regard du symbole qu'il supposerait. Était-il normal de privilégier les écrivains de langue hébraïque, alors qu'initialement le projet était autre ? Encore NON et résolument NON, si l'on veut bien admettre qu'aucun choix n'est innocent. En l'occurrence celui-ci était lourd de sens et la France n'avait pas du tout l'obligation de suivre Israël sur ce terrain ! L'ayant fait, elle ne s'honore pas comme ne s'honorent pas ceux qui se réfuigent derrière la césure entre homme de plume et citoyen...
Personne ne me persuadera que la légitimité du boycott est à géométrie variable : vrai, par exemple pour l'Afrique du Sud en son temps et injuste, voire hérétique pour la désapprobation de la politique israélienne aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui "le marché", les contrats tiennent lieu d'éthique et c'est tout bonnement insupportable.
Enfin, je ne peux terminer ce billet sans dire deux mots par rapport aux positions défendues par deux écrivains que je respecte et que je lis avec admiration. Maïssa Bey qui distingue sa qualité d'auteure et de citoyenne et Boualem Sansal qui Pense que la littérature ne doit pas être concernée par cette histoire. Je suis en désaccord avec eux et je ne doute pas que leur jugement n'a rien à voir avec de quelconques intérêts personnels. Mais je suis aussi surpris si je me réfère à ce qu'il défende si bien dans leurs livres.
Cette affaire aura au moins eu pour moi l'avantage de m'inciter à me documenter plus, à commencer par la fréquentation du blog de Ahmed Hanifi qui publie deux articles de la presse algérienne sur le sujet (L'Expression et El Watan) : http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/. Je ne serais pas complet si je ne signalais pas l'excellent site de Lounès Ramdani, référence pour tout ce qui concerne la littératrure algérienne : http://dzlit.free.fr/ ainsi que le forum qu'il anime : http://groups.yahoo.com/group/dzlit/ où la discussion a été très enrichissante.
Yahia
En clin d'œil, voici un article parlant lui du salon du livre... Algérien !
 Culture : 7e EDITION DU SALON NATIONAL DU LIVRE Nous sommes tributaires de notre histoire !
Culture : 7e EDITION DU SALON NATIONAL DU LIVRE Nous sommes tributaires de notre histoire !
Paradoxe. Comment envisager une quelconque ouverture de l’esprit culturel en Algérie lorsque l’accès au Salon national du livre se fait par un passage obligé et halte au stand dédié au président Bouteflika ? Quelle image offre cette manifestation dont les éditeurs ont choisi de boycotter le Salon international du livre de Paris parce que Israël en est l’invité principal ?
Difficile de croire que la thématique choisie pour ce salon «Ecriture et crise : esthétique ou engagement ?!» reflète la réalité.
Impossible de croire aussi que Mohamed Tahar Guerfi, président du Syndicat national des éditeurs et organisateur du salon, n’était pas au courant de cette initiative. Au-delà, il aurait pu estamper ce miroir qui nous renvoie vers l’amère vérité d’un pays soumis au diktat. Rattraper le coup et placer ce stand de la vénération parmi les autres, au mieux au dernier niveau de la Bibliothèque nationale du Hamma aurait été possible.
Le Salon national du livre à son 7e rendez-vous n’a finalement rien changé au cours de notre histoire. Nous sommes tributaires de cette identité qui à chacune de ces manifestations se retrouve dans la tourmente de la soumission politique. Parvenir à dissocier son appétit politique de celui de la lecture est apparemment impossible. Sinon comment justifier une adoration en grand format du président de la République !
Aller plus loin, avancer dans les allées du Salon du livre ne servirait presque à rien du tout puisqu’au final, la sortie se fera encore par le stand du président Bouteflika. Un stand où deux livres pour une seule écriture flashe le visiteur. Une écriture qui s’apparente à celle d’un vizir pour son roi. Il est donc plus facile d’afficher une position ferme lorsque ça concerne un autre pays.
Au premier niveau, le débat fait rage
Et là, il ne s’agit pas de cautionner ou pas le Salon international du livre de Paris, mais d’une rencontre entre journalistes spécialisés en culturelle et éditeurs. D’ailleurs, la question n’a même pas été envisagée lors de ce rendez-vous précieux.
Cependant, deux camps se sont affrontés dimanche dernier au premier étage de la bibliothèque du Hamma. Des antagonistes qui se rejoignent malgré tout dans un seul objectif : la culture de la lecture. Pour Fodil Boumala, l’animateur de cette manifestation, il est d’abord question d’envisager une solution au manque de communication promotionnelle entre les éditeurs et les journalistes.
Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de problèmes ont été posés. Chacun y est allé de sa version. De ses convictions et de sa parfaite maîtrise de la chaîne de l’édition freinée par le manque de promotionnel. Le lecteur était cet après-midi-là au centre de toutes les préoccupations. Editeurs et journalistes ont livré franco leurs contraintes et notamment leurs craintes. Ils ont partagé leur désir commun de voir le champs culturel s’épanouir. Certains des présents ont rappelé le confinement intellectuel à celui de l’engagement économique. Le livre a un prix. La promotion aussi. L’un ne pouvant se passer de l’autre, des efforts ont été fournis et des promesses de concessions ont été faites.
De la bande de Gaza à la bibliothèque du Hamma
Ce sont des échos d’une sale guerre qui frissonnent dans un coin de la bibliothèque du Hamma. Des images de Gaza, des victimes mordues par des chiens, massacrées dans un coin de Jérusalem. Des enfants périssent sous nos yeux écarquillés. Mais le choc a déjà lieu. Il y a plus d’un demi-siècle que ça dure. Nous avons déjà vu ces séquences et nous les avons déjà condamnées.
La Palestine, un peuple frère est opprimé au quotidien. Et l’Algérie ne peut pas envisager de marcher sur la mémoire piétinée dans le déroulement du 28e Salon international de Paris. Même si son comité d’organisation réfute la célébration de la 60e année de la création d’Israël. Il s’est justifié simplement par l’élection d’Israël en invité d’honneur après six années d’attente. Pour les éditeurs algériens, les Français ont manqué de tact. Ils ont choisi de célébrer la littérature israélite au détriment du malheur palestinien. Ils ont préféré l’oppresseur. Sa littérature, sa culture et son pouvoir. La France par ses auteurs a choisi librement Israël. L’Algérie par ses éditeurs et ses auteurs continue à soutenir la Palestine.
L’histoire retiendra le discours inaugural d’Ariel Sharon. Un discours empreint de mépris à l’adresse des pays arabes. Comme elle retiendra les propos méprisants de Yasmina Khadra, directeur du Centre culturel algérien à Paris. Un vis-à-vis, trompe-l’œil, l’auteur de L’Attentat se fourvoie dans son rôle. Il en oublierait même son passé d’écrivain à controverse.
Sam H. lesoirculture@lesoirdalgerie.com
Source de cet article : http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2008/03/18/article.php?sid=65853&cid=16
 Pour parler des femmes algériennes, Assia Djebar a choisi le tableau que Delacroix a peint en 1832 après être entré dans un harem de la Casbah d'Alger. 15 ans plus tard, il retravaille sa toile et la présente au salon de 1849.
Pour parler des femmes algériennes, Assia Djebar a choisi le tableau que Delacroix a peint en 1832 après être entré dans un harem de la Casbah d'Alger. 15 ans plus tard, il retravaille sa toile et la présente au salon de 1849. La première nouvelle est un ajout récent. C'est la plus longue avec "Femmes d'Alger dans leur appartement" et elle s'intitule "La nuit du récit de Fatima". En 1918, Arbia est demandée en mariage par Toumi, un de ces nombreux algériens venus au secours de la France, lors de la grande guerre, aux deux frères de celle-ci. Devant le refus de ces derniers, il l'enlève avec la bénédiction de Magdouda, la mère de la jeune fille de 14 ans. La seule fille qu'ils eurent fut Fatima. Elle va très vite avoir un demi frère puisque ses parents acceptent d'élever leur neveu Ali, fils de Hassan devenu veuf. Fatima ira fièrement à l'école française d'Aumale et un an après son départ du système scolaire sera donné au même âge que sa mère à Kacem, un homme de 35 ans, sous-officier comme son père. Elle aura un garçon, Mohammed, qu'elle va confier à Arbia qui ne se console pas du départ d'Ali pour s'engager dans la marine. Elle aura un second fils Nadir qui prendra Anissa pour femme. Il y aura aussi une naissance et là je vous laisse le plaisir de la découverte de la suite de cette très belle nouvelle.
La première nouvelle est un ajout récent. C'est la plus longue avec "Femmes d'Alger dans leur appartement" et elle s'intitule "La nuit du récit de Fatima". En 1918, Arbia est demandée en mariage par Toumi, un de ces nombreux algériens venus au secours de la France, lors de la grande guerre, aux deux frères de celle-ci. Devant le refus de ces derniers, il l'enlève avec la bénédiction de Magdouda, la mère de la jeune fille de 14 ans. La seule fille qu'ils eurent fut Fatima. Elle va très vite avoir un demi frère puisque ses parents acceptent d'élever leur neveu Ali, fils de Hassan devenu veuf. Fatima ira fièrement à l'école française d'Aumale et un an après son départ du système scolaire sera donné au même âge que sa mère à Kacem, un homme de 35 ans, sous-officier comme son père. Elle aura un garçon, Mohammed, qu'elle va confier à Arbia qui ne se console pas du départ d'Ali pour s'engager dans la marine. Elle aura un second fils Nadir qui prendra Anissa pour femme. Il y aura aussi une naissance et là je vous laisse le plaisir de la découverte de la suite de cette très belle nouvelle.